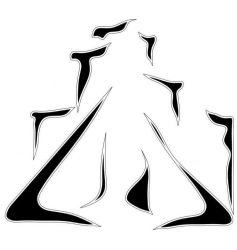Nous retranscrivons ci-dessous un article de Abdelhac paru dans la Jeune Tunisie du 15 Août 1948 à la suite de la mort de Si Farhat Ben Ayed, une figure quelque peu oubliée de la mémoire tunisienne qui pourtant aura été l’un des membres fondateurs du Destour, et qui aura été l’un des acteurs de l’activisme politiques à Paris en 1920.

“L’autre jour, nous avons accompagné jusqu’à sa dernière demeure un vieux Tunisien. Il n’était pas tellement âgé, mais avec lui, comme avec ses semblables, disparaissent une époque, des traditions, des souvenirs vécus sur les premiers pas du Destour qui, lui, a vieilli au fil des ans.
Si Farhat Ben Ayed est mort des complications d’une vieille maladie. Ni la discipline souriante du malade, ni sa docilité vis-à-vis des médecins, ni son moral de musulman n’ont pu avoir le dernier mot. Le mal l’a enlevé, sans toutefois le surprendre. Il s’est éteint doucement, plongé, dès les premières heures, dans un état de somnolence où la douleur se perd. Une mort paisible, à l’image du caractère et de la vie du défunt.
Ses parents ont dû regretter de n’avoir pas veillé ni soigné longtemps un être cher ; pour eux, c’eût été une forme de consolation, pour lui, c’était la meilleure façon de les quitter; sur la pointe des pieds, sans déranger personne, en homme du monde.
Toute sa vie, Si Farhat Ben Ayed n’a pas été autre chose. Malgré la vieillesse qui le courbait un peu, la maladie qui détruit souvent les apparences, en dépit de la modicité de la fortune aussi, il a gardé, jusqu’à la fin, une allure distinguée. Avec son complet toujours sombre, son col droit, sa cravate lâchement nouée, son fez incliné en arrière, quelqu’un d’autre aurait figuré un Tunisien moyen ou un fonctionnaire en retraite. Grâce à ses maigres atouts, Si Farhat, à son insu, tenait l’élégance par les cheveux; une élégance authentique, parce que légèrement négligée, à la manière de Maurice Barrés ou de quelque diplomate de la Sublime Porte. Dans son uniforme de garde des sceaux, il devait trancher, à la Cour, sur tant de dignitaires improvisés.
Homme du monde, il le fut surtout en société. Quelqu’un se rappellerait-il d’avoir vu cet homme en colère ? Moi je le trouvais d’une humeur égale, anglaise en quelque sorte, mais point d’air hautain, car il était à la portée de tout le monde, le sourire au visage, le compliment discret et, au bout des lèvres, un souhait au prochain ou une prière au Seigneur.
On peut être l’ami de tous sans être bon vis-à-vis de personne. Bon, sensible a la misère des autres, Si Farhat le fut ; on le savait ou on le devinait; jusqu’où pouvait aller cette sensibilité ? Je l’ai su après sa mort de la bouche des gens du peuple : le laitier, le boucher, l’épicier, le marchand de journaux, le plus éloquent de tous fut le sourd-muet, journalier à Amilcar, mon village.
Les grands savent être généreux, bien sûr. On est encore plus généreux quand on a fait l’apprentissage des privations. Si Farhat en avait vécu des mois et des mois, en plein Paris, alors capitale de l’opulence.
C’était au lendemain de l’autre guerre mondiale. Les promesses des alliés, la Conférence de la Paix, Wilson surtout, et ses 14, principes avaient donné de grands espoirs aux peuples dépendants. Paris devenait le pôle d’attraction de leurs délégations. De Tunis, Thaâlbi est parti le premier. Au service de son pays, il a réalisé une œuvre à laquelle on a cru mettre un terme en le ramenant captif dans sa patrie.
Si Farhat Ben Ayed a déployé, des efforts non moins fructueux. Auprès des ministres, des parlementaires, des journalistes, des hommes de lettres, il a été un démarcheur impénitent de la cause tunisienne. Cet homme a beaucoup fait. Ayant à servir dans les mêmes conditions, j’ose témoigner, sans offenser la vérité, que des Tunisiens œuvrant en France, aucun ne l’a dépassé.
Pour les jeunes qui l’ignorent comme pour les vieux qui l’ont oublié, Si Farhat Ben Ayed est parvenu à réaliser une belle performance avec cette pétition parlementaire en faveur de l’octroi d’un Destour à la Tunisie.
A côté des signatures des hommes de gauche, Si Farhat a pu recueillir l’adhésion des parlementaires de la droite comme Taittinger et le Prince Murat. Tous ces frères ennemis de la politique française se réconciliaient sur le plan des réformes qu’exigeait l’évolution du Protectorat. Ils le faisaient presque tous sans intérêt, comme sans calcul, convaincus et acquis par la sincérité persuasive de notre compatriote. D’aucuns sont parvenus à nourrir à l’égard de notre pays une affection comparable à la sensibilité d’un Pierre Loti aux choses de la Turquie.
Je me rappelle encore les lamentations du père Tridon dans sa « Tunisie Française » de l’époque, quand il faisait à la cause destourienne une guerre sainte de tous les jours. La pétition du Prince Murat, disait alors ce moine ligueur de la Prépondérance, c’était la clé de la maison qu’il fallait rendre à ses propriétaires tunisiens. Excessif, mais un peu vrai. De nos jours, On parlera de la valise et du cercueil, les mœurs ayant évolue.
A l’actif de Si Farhat Ben Ayed, il faut mettre la fameuse consultation juridique Barthélemy er Weiss, sur la légitimité et la légalité constitutionnelle du Destour. Tout récemment encore, on faisait appel à l’autorité des deux jurisconsultes dans le débat constitutionnel dont le dossier est resté lamentablement ouvert.
Il n’est pas question de retracer ici toute l’activité de Si Farhat Ben Ayed à Paris. Je veux simplement noter que ce Tunisien avait servi la cause de Son pays, sans avoir la dialectique de M. Blum, l’éloquence de M. Herriot, encore moins une tête bourrée de connaissances comme un clerc en Sorbonne. Par la distinction des ses manières (c’est beaucoup à Paris), par la bonté de ses sentiments, par son esprit pratique, son bon sens et sa ténacité, si Farhat a été un ambassadeur habile et heureux.
Heureux, il le fut de temps à autre, devant le succès qu’il cueillait comme un fruit au bout d’un labeur persévérant. Dans sa vie matérielle à Paris, il a été plutôt malheureux.
On ne fait pas de la politique à l’étranger avec des sourires et des bénédictions. Il y a des exigences pécuniaires impérieuses. Délégué d’un grand parti, Si Farhat ne pouvait habiter à Paris rue Saint Julien le Pauvre; il fallait être correctement mis, recevoir, inviter du monde et, souvent, gratifier des journalistes qui ne se font pas de leur métier une idée platonicienne.
Au début tout allait bien. Tunis envoyait des fonds. Puis avec le temps, les ressources ont commencé de tarir, jusqu’au jour où Tunis ne répondit presque plus. D’un côté, les sacrifices des supporters avaient des limites, de l’autre, des brebis galeuses (comme il y en a dans tous les partis) trouvaient plus intéressant de garder l’argent là où il est, au lieu de le gaspiller ailleurs.
Des témoins vous raconteront mieux que moi les vicissitudes de la vie parisienne de Si Farhat. Depuis longtemps déjà, il avait quitté le Grand Hôtel; il continuait toutefois à y recevoir son courrier moyennant quelques pièces glissées au personnel. Où est-il allé se loger ? Nul ne l’a su. Probablement dans une mansarde ou dans quelque taudis qu’il gagnait furtivement dans l’obscurité protectrice de la nuit.
Le lendemain, gai, souriant, optimiste, Si Farhat prenait une brioche et un crème bien blanc, au comptoir d’un bar, en compagnie d’un étudiant tunisien dont il réglait, bon gré mal gré, la consommation avec la sienne.
Quand il n’en avait pas les moyens, il fuyait le Quartier Latin, le bar et tous ses compatriotes. Si par hasard, l’un d’eux le repérait quelque part dans le grand Paris, Si Farhat se découvrait à l’instant des obligations politiques qui l’appelaient ailleurs de toute urgence.
Les vrais mauvais jours étaient ceux où il recevait, dans son courrier du Grand Hôtel, une lettre où des intrigants lui disaient, ou lui faisaient décrire la vie facile ou fastueuse de ses camarades à Tunis.
On divise comme l’on peut, même au prix de la souffrance…
Un jour, Si Farhat a cédé en devenant directeur du protocole.
C’est humain, disent ses amis, pour justifier la défaillance. Moi je m’interdis de la juger. Je constate simplement que cet homme, en bon musulman, ne pouvait recourir au suicide. Il lui fallait pourtant vivre. Comment ? quand il n’avait ni des rentes, ni un métier, ni une profession à exercer sous le ciel.
Il a choisi une occupation de figurant dans l’administration de son pays. Et Il a exercée jusqu’à sa mort, sans avoir à desservir une cause ni a compromettre quelqu’un. L’ayant connu durant cette retraite forcée, j’ai discerné dans son regard la gêne où il se trouvait de porter un uniforme. Et j’en ai un peu voulu à des amis communs qui le taquinaient, sans méchanceté. Lui, répondait discrètement, à sa manière, par un sourire mélancolique qui semblait être un long plaidoyer.
Je ne crois pas le trahir en disant que, jusqu’à son dernier souffle, il ne s’est point désintéressé de l’avenir de la Tunisie.
Je l’ai vu pour la dernière fois ; c’était chez lui où j’avais hésité d’aller, de peur de le gêner.
Par l’architecture, la demeure devait lui rappeler ses origines et tout le passé. Le présent ? Des canapés ornés de cretonne autour d’une table couverte de toile cirée. Des journaux, quelques brochures, un vase plein d’œillets.
Nous avons parlé de sa santé, de politique et de fleurs (il tenait à m’offrir les seules qu’il avait). Contrairement à mes prévisions, il s’est plu à me recevoir dans ce cadre modeste. J’étais parfaitement à l’aise. Je dirais même que je l’ai beaucoup aimé ainsi. Un grand seigneur, loin des décors trompeurs de la vie, vous tendant une main affectueuse, vous parlant avec son cœur de nobles sujets.
Croyons-le : malgré les apparences, Farhat Ben Ayed fut un bon Tunisien et un grand honnête homme. Guidé par l’instinct, j’ai pleuré le compatriote et l’ami.”

(La Jeune Tunisie)
15 août 1948
Par Abdelhac