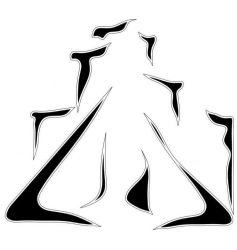Il y avait à peu près six mois qu’une femme, qui n’avait pas de rivale en beauté, était arrivée à Paris, où son entrée dans le monde avait fait sensation; on s’accordait à dire qu’elle possédait une immense fortune, et l’on savait qu’elle n’était venue à Paris que pour visiter ce que la capitale renfermait de plus séduisant et de plus curieux. Grande, brune, avec une figure douce, des traits admirables, des épaules magnifiques, un port de reine, une toilette pleine de goût, Ben-Aïad (c’était le nom de l’étrangère) méritait certaine ment qu’on s’occupât d’elle. Ben Ayed était continuellement en mouvement. A deux heures, on la voyait aux Champs-Elysées ; à trois heures, au Palais-Royal; à huit heures, au théâtre. Son hôtel était envahi tous les jours par une foule d’importuns qui venaient lui présenter leurs hommages. Quoique ces continuelles réceptions ne fussent pas du goût de Ben-Aïad, elle accueillait cependant ses visiteurs avec une grâce si parfaite que ceux-ci, pour la plupart, ne la quittaient qu’en se promettant de revenir la voir.
L’étrangère sortait toujours seule, et cette circonstance n’était pas celle qui intriguait le moins. Agée au plus de vingt-cinq ans, ayant un grand usage du monde » dans lequel elle brillait non-seulement par ses qualités physiques, mais encore par celles de son esprit, Ben-Aïad n’avait certainement que l’embarras du choix pour prendre un époux parmi ses nombreux adorateurs. Avait-elle donc fait vœu de célibat? Un certain jour cependant, des gens dignes de foi affirmèrent l’avoir vue dans son carrosse en compagnie d’un monsieur âgé. Sa voiture, assuraient-ils, avait suivi la ligne des boulevards et s’était engagée dans l’avenue des Champs-Elysées. Cette nouvelle ne fut pas plutôt accréditée, que tous ceux qui avaient contribué à faire de Ben-Aïad leur idole, s’empressèrent de la briser. L’étrangère, tout d’un coup, descendit au rang de courtisane, et les quelques désœuvrés qui s’occupèrent encore d’elle y furent poussés par la curiosité de savoir à qui elle avait accordé ses préférences.
Le fait cependant n’était exact que sur un point seulement : celui de la présence du monsieur dans la voiture de Ben-Aïad mais il n’était pas vrai que cet homme eût obtenu les faveurs de l’étrangère. Le personnage en question était consul de France en Egypte. Reçu plusieurs fois dans les salons de Ben-Aïad, il avait fait sa connaissance, et s’était cru dans l’obligation de lui présenter ses hommages en revenant à Paris, où il ‘avait été appelé momentanément pour affaires politiques. L’étrangère, en lui offrant une place dans sa voiture, ne croyait certainement pas commettre une imprudence. Alfred, qui avait entendu parler de la princesse et qui savait qu’elle fréquentait assidûment l’Opéra, s’y rendit un soir dans l’intention de la voir. A peine venait-il de se placer, que la porte d’une loge, qui faisait face à la sienne, s’ouvrit et donna passage à Ben-Aïad. Le consul était derrière elle.
Un murmure d’admiration l’accueillit à son entrée. Alfred ne put détacher son regard de cette femme dont la beauté le ravissait, et il n’eut plus qu’un désir : celui de lui parler. Au premier entr’acte, il se rendit donc à la loge de Ben-Aïad et demanda la faveur de lui présenter ses civilités. Il n’eut qu’à décliner son nom pour être reçu. L’accueil que lui fit l’étrangère fut si charmant, qu’Alfred ne se rendit compte du temps qu’il avait passé auprès d’elle que quand on leva le rideau. Alors il s’excusa et voulut partir, mais Ben-Aïad le pria de vouloir bien rester dans sa loge jusqu’à la fin de la pièce, ce qu’il accepta. Le consul, cette fois, se trouvait relégué au second plan.
— Je prends un grand intérêt, dit l’étrangère à Alfred, à tout ce que j’entends dire de vous dans le monde. J’ai visité moi-même les établissements publics que vous avez fondés, et je déclare que j’ai été émerveillée de la façon intelligente suivant laquelle les soins sont donnés à vos protégés. Vous me laisserez la satisfaction, je l’espère, de concourir, dans une certaine mesure, au développement de vos idées philanthropiques. Je regrette de m’y prendre si tard, mais c’est aujourd’hui, pour la première fois, vous le savez, que j’ai l’avantage de me trouver avec vous.
— Madame, répliqua Alfred, c’est à moi qu’il appartenait de solliciter votre concours et je m’accuse de ne l’avoir pas fait. La crainte d’être pris pour un importun est ma seule excuse.
— Il n’y a d’importuns que les gens sans esprit, répondit l’étrangère en dirigeant son regard vers le consul qui devint pourpre ; vous ne serez jamais du nombre.
— Monsieur, sans doute, est un de vos parents ? dit Alfred en saluant le consul. — Monsieur est le consul de France en Egypte, répondit négligemment Ben-Aïad; mais son séjour à Paris ne peut plus être de longue durée maintenant, attendu que les affaires qu’il avait à traiter sont sur le point d’être terminées.
— J’avais l’intention, Madame, de demander un congé d’un mois, dit le consul d’une voix tremblante; mais comme je ne veux pas vous désobliger, je partirai quand ma mission sera finie.
— Comme il vous plaira, Monsieur; vous êtes parfaitement libre d’agir comme il vous convient. Le consul ne répondit rien, mais il serra les poings avec colère.
— Ne trouvez-vous pas, continua l’étrangère en se retournant vers Alfred, que cette pièce est ennuyeuse? Sur ma parole, nous n’avons plus de bons auteurs.
— Je suis de votre avis, Madame. Si même votre intention est de quitter la salle avant la fin de ce dernier acte, je vous demanderai la faveur de vous reconduire jusqu’à votre hôtel.
— Je vous prie seulement de m’accompagner jusqu’à ma voiture, dit Ben-Aïad en se levant. Cette dernière phrase, qui accordait au consul un congé plus long que celui qu’il voulait solliciter, lui mit la rage au cœur. Il saisit son chapeau, salua la princesse Ben Ayad, et sortit en jetant un regard haineux sur de Lathélize.
— Vous vous êtes fait un ennemi, Monsieur, dit Ben-Aïad, prenez garde ! les gens sans esprit sont ordinairement vindicatifs et méchants.
— Celui-ci n’est point à craindre, répondit Alfred en souriant. Et, offrant son bras à l’étrangère, il descendit avec elle et la reconduisit jusqu’à son carrosse.
— Maintenant que je suis votre débitrice, lui dit-elle, vous ne refuserez sans doute pas de venir me voir. Vous saurez que je n’aime pas à attendre pour régler mes comptes. Alfred fit la promesse qu’on exigeait de lui, et quand Ben Ayed l’eut quitté, il monta lui-même dans sa voiture et rentra chez lui.
Le lendemain, au moment où Alfred se disposait à sortir, Joseph lui présenta une carte. C’était celle du consul.
— Fais entrer, dit-il. Joseph introduisit le consul dont les lèvres tremblaient de colère, malgré les efforts qu’il faisait pour se contenir.
— La visite que j’ai l’honneur de vous rendre, Monsieur, dit-il, ne doit pas vous étonner. Je suis certain que vous deviez m ‘attendre.
— Votre visite m’honore, répondit Alfred, mais je n’en vois pas encore le but. Dans tous les cas, soyez le bienvenu et veuillez-vous expliquer.
— Je pensais, Monsieur, que vous m’épargneriez cet ennui ; mais puisque vous exigez que je m’explique, je m’expliquerai. Vous vous souvenez sans doute de votre entrée dans la loge que nous occupions, la princesse et moi, hier soir, à l’Opéra?
— Parfaitement, Monsieur.
— Vous n’avez également pu oublier qu’à la suite de la conversation que nous avons engagée avec elle, j’ai été éconduit de la façon la plus ridicule qu’il soit possible d’imaginer?
— Permettez. Je me souviens très-bien de tout ce que j’ai dit dans cette soirée, mais je ne me rappelle pas qu’un ridicule quel conque ait été jeté sur vous.
— Vous ne me forcerez pas, je l’espère, à reproduire cette scène! dit le consul d’une voix frémissante. J’ai été froissé et insulté devant vous et j’ai le droit de vous en demander raison.
— Je conteste votre droit; aussi me permettrez-vous de ne pas accepter ce que vous me demandez.
— Vos motifs ? — Ils sont simples. Je n’accepte la responsabilité d’un acte que quand cet acte émane de moi ; or, comme je ne sache pas vous avoir insulté, je n’ai par conséquent pas … Le consul ne le laissa pas achever.
— Dans ce cas, Monsieur, je dis que vous n’êtes qu’un lâche ! — Vous regretterez, j’en ai la conviction, de m’avoir poussé à bout, dit Alfred avec un grand sang-froid. — J’attends vos ordres.
— Je prendrai les vôtres.
— Trouvez-vous alors, ce soir même, à quatre heures, à la porte de Saint-Mandé. — J’y serai avec mes témoins. Votre arme?
— Le pistolet.
— C’est entendu. Le consul fit un salut et sortit.
— Imbécile! murmura Alfred en haussant les épaules. Quand je pense que c’est son sot amour-propre qui lui fait commettre une pareille sottise ! Ce disant, il jeta un regard sur sa pendule et vit qu’il était dix heures.
— J’ai bien juste le temps de me procurer des témoins, se dit- il; il faut que je sorte à l’instant. Au moment où il allait sonner Joseph, celui-ci entra et lui remit une seconde carte.
— Le marquis de Boisguyon ? exclama de Lathélize avec étonnement ; mais je ne le connais pas ! N’importe, fais-le entrer. Après les salutations d’usage, de Boisguyon expliqua à Alfred qu’il venait le voir dans l’intention de s’entendre avec lui au sujet de la création d’un orphelinat. Il lui dit qu’il s’associait de tout cœur à ses œuvres charitables et qu’il était tout prêt à lui prêter son concours. Il termina en disant qu’il serait heureux qu’Alfred lui indiquât le moyen de dépenser convenablement ses revenus.
— Je suis flatté, Monsieur, que vous ayez songé à me venir me trouver dans cette circonstance, répondit Alfred ; je me mets dès à présent à votre disposition. Seulement je dois vous dire que je suis si pressé en ce moment qu’il m’est impossible de vous accorder un plus long entretien. Vous allez en juger vous-même. De Lathélize rapporta alors en quelques mots ce qui s’était passé entre lui et le consul.
Le marquis répliqua :
— Eh! mais, Monsieur, votre premier témoin est tout trouvé, si toutefois vous voulez me faire l’honneur de m’accepter comme tel.
— Volontiers, Monsieur le marquis. Dans ce cas, si vous voulez accepter une place dans mon coupé, nous nous mettrons tout de suite en quête de trouver le second. — Avec plaisir, Monsieur, répondit de Boisguyon. Une demi-heure après, Alfred se présentait chez un de ses amis, qui consentait à le suivre, et tous trois allaient déjeuner, en attendant qu’il fût l’heure du rendez-vous.
— Soit alors, vous l’aurez voulu, dit Alfred. Et, étendant le bras dans la direction de la poitrine de son adversaire, il l’atteignit au cœur. Celui-ci tomba foudroyé. On le transporta aussitôt dans la voilure qui l’avait amené, et quand les témoins eurent déclaré que tout s’était loyalement passé de part et d’autre, Alfred reconduisit son ami ainsi que de Boisguyon, à leurs domiciles respectifs ; puis après, avoir quitté ce dernier et lui avoir fait promettre de revenir le voir, il remonta dans son coupé et lança à son groom l’adresse de Ben-Aïad ! L’étrangère ne témoigna aucun chagrin en apprenant la mort du consul, mais elle fut épouvantée en songeant au danger qu’avait couru De Lathélize pour lequel elle éprouvait déjà un sentiment qu’elle cherchait vainement à combattre. Ce sentiment grandit même si vite avec le temps qu’elle en vint au point de laisser entrevoir à Alfred le désir qu’elle avait de l ‘épouser ; mais celui-ci ne l’eut pas plutôt devinée, qu’il devint tout à coup plus circonspect à son égard.
Le souvenir de Rose occupait une si grande place dans son esprit, qu’il en arriva à ne plus rendre visite à Ben-Aïad qu’à de rares intervalles et finit, plutôt que de feindre un amour qu’il n’éprouvait pas, par rompre toutes relations avec elle.
Quand l’étrangère fut convaincue qu’Alfred l’avait abandonnée, elle en conçut un chagrin si violent que lie résolut de se détruire. Un certain jour, tout Paris apprit que la belle Ben Ayed s’était empoisonnée par désespoir d’amour. Cette fin tragique et inattendue frappa chacun de stupeur. Les uns blâmèrent énergiquement De Lathélize et l’accusèrent d’être l’auteur de la mort de Ben-Aïad; d’autres, plus enthousiastes pour les faits scandaleux, se plurent, au contraire, à faire son éloge. Quoi qu’il en fut, ce fatal événement jeta un nouveau voile de tristesse sur l’âme déjà si éprouvée d’Alfred et ce ne fut que long temps après qu’il parvint à l’oublier.

France 1931-07-19